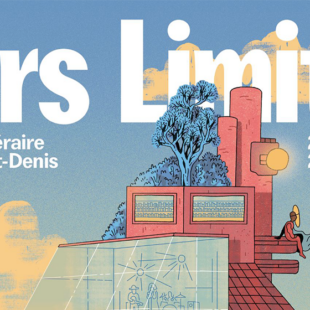Deux flâneurs explorent l’âme du « Neuf-Trois »

- Agacée par les clichés rabâchés par les médias, l'écrivaine allemande Anne Weber a décidé de traverser le périphérique pour sillonner la Seine-Saint-Denis avec un ami.
- Elle a puisé dans ses pérégrinations la matière du roman itinérant "Neuf-Trois".
- Rencontre avec une promeneuse "étrangère", qui a posé un regard neuf sur un territoire plutôt méconnu des Parisien·nes.
 Vous êtes une romancière et une traductrice qui vit à Paris depuis plus de 40 ans. Pourquoi avez-vous souhaité écrire un livre sur notre département ?
Vous êtes une romancière et une traductrice qui vit à Paris depuis plus de 40 ans. Pourquoi avez-vous souhaité écrire un livre sur notre département ?
Un ami franco-algérien, qui a toujours vécu dans le 93 m’a proposé un jour de l’accompagner dans une balade à travers ce département. Cela a été presque un choc pour moi qui habite le 19ème arrondissement. Je me suis rendue compte que je ne m’étais jamais intéressée à ce territoire qui n’est qu’à quelques stations de métro de chez moi, peut-être à cause des images négatives véhiculées par les médias. Ceci m’a donné envie d’explorer en 2023 ce territoire très vaste, densément peuplé et très différent des représentations véhiculées par les médias. J’ai découvert toute une couche d’histoires liées à l’Histoire de France qui se sédimentent dans les paysages : celle de l’Occupation, de la Colonisation, des différentes vagues d’immigration… Pour m’immerger dans ce département, marcher dans les 40 villes me semblait la meilleure stratégie qui permettait des rencontres les plus directes qui soient avec les habitants. En plus, j’ai eu la chance d’être accompagnée par un ami, que j’ai appelé Hocine, originaire du 93 et dont j’ai transformé un peu l’histoire, qui m’a dévoilé le quotidien des Séquano-Dionysiens de l’autre côté du périphérique, qui m’a parfois un peu surpris.
Pourquoi avoir fait le choix de faire de longues marches en Seine-Saint-Denis ? Vous auriez pu prendre la voiture…
Pour s’imprégner réellement d’un territoire, il vaut mieux être dans la rue, rencontrer les habitants, s’intéresser à leur vie de tous les jours… Avec Hocine, nous avons fait entre 12 et 22 km de zigzags tous les jours pendant six mois en arpentant tous les coins du territoire. Je me suis rendue compte que la banlieue n’est pas un territoire fait pour la marche, même s’il commence à être aménagé pour les vélos. En longeant des nationales, on arrive dans des endroits pas vraiment faits pour la promenade, qui ressemblent à des no mand’land où vit une population oubliée. Chaque chapitre du roman débute par une station de métro ou de RER et décrit un périple dans plusieurs quartiers ou les discussions avec Hocine qui s’apparentaient un peu à un jeu de rôle entre « l’intérieur » (lui qui connaît très bien le département) et « l’extérieur » (moi qui ait grandi à en Allemagne et qui portait un regard de Candide sur le territoire).
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ces longues balades en Seine-Saint-Denis ?
J’ai été surprise par le côté très contrasté d’un territoire. A La Courneuve, nous avons sillonné les vestiges de la Cité des 4000, un espace résidentiel, des bars… puis en prenant plusieurs rues, nous avons croisé la friche industrielle Babcock, un bâtiment blanc qui a servi d’usine dans les années 50 (NDLR : devenue un espace pour le street-art). Plus loin, on trouve un édifice reconverti dont la façade est ornée de statues colorées qui est un temple hindou très fréquenté. En suivant l’autoroute, vous croiserez les nouveaux bâtiments de la Banque de France qui possède des réserves de billets énormes, ce qui paraît paradoxal dans un des départements les plus pauvres de la France métropolitaine. Ce contraste est très frappant également dans d’autres villes comme Noisy-le-Grand avec ses sites grandioses comme le Palais d’Abraxas ou les Arènes de Picasso, des grandes barres, des espaces résidentiels ou très multiculturels ou des endroits plus naturels comme les bords de Marne.
Nombre de mes amis installés à Paris connaissent très peu et ne se déplacent pas en Seine-Saint-Denis alors que les banlieusards au contraire viennent souvent dans la capitale profiter de la vie culturelle. Il y a une frontière mentale très nette, incarnée par le périphérique, entre les territoires intra-muros et extra-muros qui apparaît aussi dans l’architecture, les paysages urbains… J’ai l’impression que ce phénomène est plus marqué à Paris que dans d’autres capitales européennes.

On sent dans votre livre, qui ressemble à un roman d’exploration, que vous vous êtes beaucoup renseignée sur l’histoire de la banlieue parisienne, ses bâtiments… Vous confirmez ?
J’ai essayé d’être rigoureuse pendant ces 6 mois de balades, en prenant beaucoup de photos, des notes sur les endroits ou les habitants rencontrés. Certaines recherches que j’ai pu faire sur les lieux que nous avons visités m’ont étonnée. Je n’aurai pas imaginé par exemple que le célèbre Albert Uderzo, un des pères d’Astérix, a vécu des dizaines d’années dans le quartier du pont de Pierre à Bobigny. Hasard de la vie, une grande nécropole gauloise avec de nombreux objets archéologiques a été découverte au cœur de l’hôpital Avicenne, à proximité de la cité où ce personnage de BD était né. Le hub sportif du PRISME (NDLR : bâtiment accessible à tous les publics quelque soit leur handicap construit en héritage des Jeux paralympiques 2024) est sorti de terre à quelques pas de là. J’ai été marqué également par le nom des rues qui témoigne du passé communiste de certaines villes. De même, le rapport des Français à leur histoire est très différent à celui des Allemands. Ainsi, le nombre de monuments aux morts recensant de manière indifférenciée les soldats tombés pendant les guerres mondiales ou les guerres coloniales a attiré mon attention, sans doute parce que l’Allemagne, du fait de son expérience du nazisme, se doit d’avoir un rapport très éthique vis-à-vis de ce qui a été une forme d’Empire de 1940 à 1944.
La France n’en a pas fini avec son histoire coloniale et la Seine-Saint-Denis, écrivez-vous, est un révélateur de cette histoire des migrations, de métissages…
Oui, tout à fait. Plusieurs générations d’immigrés souvent maghrébins se sont installés dans ce territoire avant et après les mouvements de décolonisation. Ce côté creuset marque clairement cet espace avec d’autres communautés asiatiques, roumaines, africaines, sri-lankaises… Ces habitants, parfois oubliés par la capitale, ont marqué cet espace de leur empreinte comme le marathonien dionysien Boughera El Ouafi qui a gagné la médaille d’or pour la France en 1928 alors qu’il n’avait pas les mêmes droits civiques que les Français. J’ai essayé aussi de montrer le double attachement de certains citoyens d’origine étrangère à la fois aux valeurs de la République et au combat pour la décolonisation et l’ambivalence parfois entre ces deux sentiments. Hocine, qui m’accompagne lors des balades parle souvent d’Hocine Aït Ahmed, un des premiers maquisards d’Algérie, figure du FLN qu’il admire, tout en tenant à son héritage français. Les cultures se croisent dans ce territoire en mutation qui ressemble à un laboratoire avec son patrimoine historique unique et insuffisamment connu avec la Basilique de Saint-Denis, l’hôpital de Ville-Evrard où ont vécu Antonin Artaud et Camille Claudel, ses quartiers prioritaires qui peuvent jouxter des data-centers ultra-modernes…
Par ailleurs, j’ai essayé de montrer la confrontation de points de vue, les frictions quelquefois qui peuvent exister entre la « fausse Parisienne » un peu naïve que je jouais et les réactions de mon ami Hocine, qui se moquait par exemple de ma volonté de garder certains souvenirs de nos périples comme des objets abandonnés.
Vous avez effectué cette exploration en 2023 lors de la préparation des JOP. Vous avez observé les transformations dues à cet événement ?
Effectivement, pendant cette période, certains quartiers olympiques était couvert par une forêt de grues immenses. Les équipements sportifs comme le PRISME, le centre aquatique… le Grand Paris Express ont métamorphosé le territoire mais je me suis davantage concentrée sur les modes de vie, le ressenti des habitants et la façon dont ils vivent leur territoire, dont ils sont fiers malgré les clichés sur la banlieue, l’économie informelle qui existe effectivement. Malgré ces explorations, ce Département reste pour moi de l’ordre du mystère, avec une part d’insaisissable que je ne suis pas arrivée à percer. Un lieu revient souvent comme un fil rouge dans mon roman, un café que nous avons beaucoup fréquenté avec Hocine, où se fréquentent des Français, des pas Français, des jeunes, des vieux, des femmes, des immigrés d’Afrique du Nord, des anciens combattants… qui cohabitent de façon un peu miraculeuse sous la protection de Rachid le patron. Une petite communauté à laquelle je me suis attachée et dont j’ai demandé symboliquement la protection à la fin de mon roman dans une église de La Courneuve fréquentée par la communauté tamoule.
Roman « Neuf-Trois » d’Anne Weber aux Editions Philippe Rey

Crédit-photo : Mara Mazzanti et Irmeli Jung