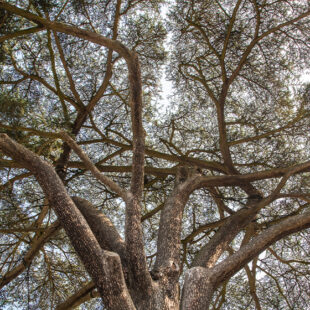Trois centres dramatiques nationaux, trois sensibilités (2)

- La Seine-Saint-Denis compte sur son territoire centres dramatiques nationaux, soutenus par l'Etat et par le Département.
- Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis, Théâtre de la Commune à Aubervilliers et Théâtre public de Montreuil représentent autant de chances pour les artistes et les spectatrice·eurs.
- Leurs directrices et directeurs nous les présentent. Deuxième de la série, Julie Deliquet, du Théâtre Gérard-Philipe.
-
Lorsqu’on apprend sa nomination à la direction d’un centre dramatique national, qu’est-ce qu’on se dit ?
C’était à un moment si particulier ! En ce début d’année 2020, on sortait des manifestations contre la réforme des retraites et on voyait poindre la pandémie de Covid 19. Lorsque je suis arrivée au Théâtre Gérard-Philipe que je connaissais bien puisque j’y avais été artiste associée, ça parlait de la pandémie et Jean Bellorini, le précédent directeur, a dit « ça, c’est pour elle ! ». J’ai compris à l’instant qu’alors le problème était d’ampleur planétaire, qu’il serait pour moi question du devenir d’une équipe permanente, avec un théâtre fermé. En prenant mes fonctions, je me suis posé la question de que faire de nos métiers sans lieu ? Sans nos activités ? Quelle est notre fonction au sein de la cité ? Quelle est la fonction de nos équipes permanentes et intermittentes ? Que signifie la démocratisation culturelle et être un service public de l’art et de la culture ? Je me suis tournée vers l’école, les autres services publics comme l’hôpital et tous les relais associatifs extrêmement mobilisés sur le territoire pour que le lien humain perdure. Même au plus fort du confinement ils ont manifesté le besoin de maintenir le lien avec nous. Penser ensemble à l’après déconfinement était une manière de commencer à travailler le retour au lien et à réfléchir à la place de la culture au sein de la ville de Saint-Denis. Comment les relais publics pourraient retrouver une activité face à des citoyens qui avaient vécu des confinements parfois extrêmement difficiles. Il était question de gratuité, de billetterie solidaire et puisqu’il était interdit de d’accueillir les habitants dans nos murs, comment pouvions-nous déplacer nos murs ? Car l’école était maintenue en distanciel, comment pouvions-nous travailler avec les soignants et les soignés, avec les structures sociales de la jeunesse… Dans le département le plus jeune de la France métropolitaine, il était important lors des vacances de mettre en place un été culturel avec des ateliers gratuits. Ce qui perdure aujourd’hui car les vacances d’été sont longues et les jeunes et les enfants qui partent ne sont pas nombreux. Donc, je ne l’ai jamais analysé vraiment, mais entre ce que je me suis raconté avant d’être nommée et mes premiers pas de directrice, j’ai beaucoup changé !
-
Ce théâtre, est-ce un bel outil ? Pourquoi ?
Oui, pour plusieurs raisons. Le bâtiment en lui-même, c’est vraiment le bâtiment des habitants, nous nous ne sommes que de passage. Il est en centre-ville, ce qui n’est pas le cas de tous centres dramatiques nationaux. C’est important pour pouvoir s’y rendre facilement. Et il est le fruit d’une pensée qui émane de 1945, celle de la démocratisation culturelle, allier l’exigence artistique et le travail avec les spectateurs, et le travail pour l’adapter au monde d’aujourd’hui. J’ai lu un livre qui disait : qu’on soit médecin, ouvrier, enseignant ou artiste, peu importe le résultat, c’est la tentative qui est belle. J’ai l’impression que ces maisons ont été pensées pour la tentative. Elles ont une grande exigence parce qu’elles ont été pensées pour ne jamais s’arrêter et se replier sur elles-mêmes, mais chercher à transmettre. Moi j’ai rencontré l’art grâce à l’école par des œuvres qui n’étaient pas destinées à la jeune fille que j’étais. Mais on les a rendus accessibles et à un moment donné j’ai eu la sensation qu’il était possible que ça s’adresse à moi. C’est ça qu’il faut travailler. La tentative, et la rencontre. Pas question de créer seul dans son coin.
-
Qu’est-ce qui vous fait dire « ce spectacle, j’ai envie de le programmer ? »
Cela tient à une rencontre avec un artiste, car je ne programme pas de pièce que j’ai déjà vue mais je vais accompagner la création d’une nouvelle. Ce que j’aime c’est rentrer dans le monde de l’artiste, il y a une sorte de fil rouge qui se détache, une thématique qui nous relie au monde. Cela crée un lien, qui me permet de privilégier des séries. Non pas une multiplicité de titres mais une complémentarité de thèmes traversés par des esthétiques différentes. Il y a toujours une problématique sociale et politique abordée d’un point de vue humain. (…) Et je me demande : « est-ce que ça va bien pour le TGP ? » Je pense à mes équipes, mais aussi à l’âge de notre salle car 40% de notre public à moins de 26 ans.
-
Quelle est votre méthode pour aller au-devant du public?
Il faut partir de l’œuvre pour créer des projets, et non créer des projets et après de se dire quelle œuvre pourrait y répondre. L’œuvre est toujours le point de départ. Ensuite, il n’y a pas de formule pour toucher le public, il y a des propositions, et ces propositions sont elles-même artistiques. (…) Ensuite il faut aller au-devant, travailler à l’échelle d’une salle de classe, d’une salle de spectacle, d’une classe en formation infirmière, d’un atelier théâtre dans une maison d’arrêt ou d’un centre social. Il faut donner accès. Nous avons beaucoup de liens avec les écoles, les collèges, les lycées et nous avons la chance de pouvoir programmer des œuvres pour tous les âges de la vie. Nous avons un festival Et moi alors ? avec 7 à 8 propositions pour le jeune public tout au long de l’année. Et nous soignons aussi la pré-adolescence, l’âge du collège qui est souvent oublié de nos programmations, avec une création par an. Et chaque année nous avons un projet de création avec les habitants, avec les artistes associés, en lien avec le fil rouge de la saison. Cela demande beaucoup d’adaptabilité selon les publics avec lesquels on travaille. Si on travaille avec les associations par exemple sur la question de la non-transmission des langues maternelles et paternelles au sein des familles dionysiennes, ça veut dire qu’il faut s’adapter au moment de la journée où on peut aller nous travailler avec les familles, quand est-ce qu’elles vont venir travailler ? C’est du cousu main ! C’est très stimulant car ça nous permet d’avoir toujours des saisons très ancrées dans le réel, mais cela demande du temps, et donc de l’argent.
Mais une des choses que les centres dramatiques nationaux veulent protéger, c’est le rapport au temps. Aujourd’hui lorsqu’on est sur une plate-forme en ligne et qu’on veut louer un film, on nous « Vous avez 48 heures pour consommer votre film. » L’idée est de sortir de la notion de produit pour favoriser la question de la production. La production c’est du temps long. La production c’est beaucoup d’invisible. La production c’est aussi beaucoup de moments en dehors de nos salles de répétition, liés à toutes les actions artistiques qu’on pense et qu’on ne reproduit pas d’un projet à l’autre parce que le projet n’a rien à voir avec celui d’avant et qui ne va pas être travaillé au même endroit. Et ça, ça a besoin d’être pensé et qu’on y accorde du temps.
-
Depuis votre arrivée, avez-vous eu de bonnes surprises ?
J’ai été très impressionnée par la solidarité et par l’élan humain à la sortie du premier confinement et de voir comment un territoire répondait à une réalité sociale difficile. Aussi par l’inventivité, en termes associatifs, en termes caritatifs, prendre du temps pour penser des projets avec les élèves plutôt que reprendre le programme scolaire… J’avoue qu’en tant que créatrice, artiste, j’ai été spectatrice d’un territoire où la question humaine était incarnée à chaque coin de rue, avec un point de vue citoyen assez bouleversant. C’est alors que je me suis dit que la question du service public était la question majeure de notre société et je voyais des hommes, des femmes et des enfants au travail pour les autres, beaucoup plus qu’ailleurs et tellement en contradiction avec ce qui était véhiculé dans les médias à propos de ce territoire. Là je me suis pris une petite claque ! Sur la question de la solidarité, de l’autogestion… Avec des vraies emmerdes on cherche des grandes solutions quoi ! Et ça, j’avoue que ça m’a ça m’a marquée au fer rouge. Du coup ça m’a donné un élan, j’ai eu envie de travailler sur l’héritage ouvrier de ce territoire, sur les luttes, sur ces combats politiques…
-
Qu’est-ce qui vous guidera dans la construction de votre prochaine saison ?
La prochaine saison abordera la thématique de la place des femmes dans les guerres, qui est une question désormais européenne et mondiale, par guerre j’entends les conflits. On peut remonter certaines pièces du répertoire avec une vision d’aujourd’hui, travailler cette question de la mémoire. La mémoire peut être une transmission d’humain à humain aussi bien qu’une arme dictatoriale, elle nous forme dans nos livres d’histoire. Raconter notre histoire d’hier pour pouvoir nous alerter sur les dangers de la société d’aujourd’hui.
-
Avez-vous un rêve avec ce théâtre ?
Je voudrais travailler avec des jeunes sur les luttes ouvrières. Sur la différence entre les luttes ouvrières d’hier et celles d’aujourd’hui. On se battait avant pour avoir quelque chose qu’on n’avait pas et aujourd’hui on doit se battre pour maintenir ce qu’on a. C’est très différent comme logique. Toutes les crises que nous traversons, sanitaires, économiques, écologiques, politiques nous impactent et remettent en question l’accès pour tous à un service public de l’art et de la culture. Je suis convaincue que chacun et chacune a le droit de rencontrer l’art tôt dans sa vie et d’en faire ce qu’il·elle en veut plus tard. Ce droit est fragile et essentiel.
Photo : Pascal Victor